Paru aux Etats-Unis en 1976, sous le titre Our blood : Prophecies and Discourses on Sexual Politics, réédité avec une nouvelle préface en 1981, il est pour la première fois traduit et publié en français par les Editions des femmes en 2021.
Ne trouvant plus d'éditeur pour ses textes après la parution de Woman Hating que l'éditeur n'avait pas aimé, quelle idée aussi d'écrire noir sur blanc "les femmes sont violées" !, Andrea Dworkin, qui a quand même besoin de gagner sa vie, et ne veut rien faire d'autre qu'écrire, a alors l'idée de se lancer dans une tournée de conférences pour lire sa prose devant un public universitaire. Elle fait des kilomètres accompagnée de sa chienne berger allemand, et elle parle devant une majorité de femmes qui reconnaissant dans ce qu'elle dit ce qu'elles vivent et affrontent quasi quotidiennement, l'ovationnent, l'attendent en pleurant à la sortie. Cet ouvrage reproduit neuf conférences : c'est du Dworkin, chirurgical, elle dissèque l'oppression à l'os, la construction sociale de la féminité cette impuissance, et de la masculinité cette toute-puissance. C'est puissant, c'est magnifique et c'est une oeuvre d'écrivaine, ce qu'elle voulait être. Cet ouvrage est indispensable pour se constituer une culture féministe. Je vous propose ci-dessous deux extraits de sa prose : un sur les mères, et un sur la crainte qui nous fait toutes nous tenir à carreau.
LES MÈRES
" C'est le premier devoir des mères sous le patriarcat de former des fils héroïques et de faire en sorte que leurs filles soient disposées à s'adapter à ce qui a été décrit à juste titre comme "une demi-vie". Toute femme est censée dénigrer n'importe laquelle de ses pareilles qui dévie des normes acceptées de la féminité, et la plupart le font. Ce qui est remarquable, ce n'est pas que la plupart le font, mais que certaines ne le font pas.
La position de la mère, surtout, dans une société suprémaciste masculine, est absolument intenable. Freud, dans encore un autre élan stupéfiant de perspicacité, a affirmé : "Seule la relation avec le fils apporte à la mère une satisfaction illimitée : c'est, d'une manière générale, la plus parfaite et la plus dénuée d'ambivalence de toutes les relations humaines." Le fait est qu'il est bien plus facile pour une femme d'élever un fils qu'une fille. D'abord, on la récompense pour avoir porté un fils -elle atteint par là l'apogée de la réussite possible de sa vie, selon la culture des hommes. On pourrait dire qu'en portant un fils, elle a possédé un phallus pendant neuf mois dans son espace vide, et cela lui assure une approbation qu'elle ne pouvait remporter d'aucune autre façon. On attend d'elle ensuite qu'elle investisse tout le reste de sa vie à entretenir, à nourrir, à soigner et à sacraliser ce fils. Mais le fait est que ce fils bénéficie d'un droit de naissance à l'identité qui, à elle, lui est dénié. Il bénéficie d'un droit à incarner de vraies qualités, à développer des talents, à agir, à devenir -à devenir qui ou ce qu'elle ne pouvait pas devenir. Il est impossible d'imaginer que cette relation ne soit pas saturée d'ambivalence pour la mère, d'ambivalence et de franche amertume. Cette ambivalence, cette amertume, est inhérente à la relation mère-fils parce que le fils finira inévitablement par trahir la mère en devenant un homme -c'est à dire en acceptant son droit de naissance au pouvoir sur et contre elle, et celles de sa sorte. Mais pour la mère, le projet d'élever un fils est le projet le plus gratifiant qu'elle puisse espérer. Elle peut l'observer, en tant qu'enfant, jouer aux jeux qui lui étaient interdits ; elle peut l'investir de ses propres idées, aspirations, ambitions et valeurs -ou tout ce qu'il en reste ; elle peut observer son fils qui est né de sa chair et a été maintenu en vie grâce à son travail et à son dévouement, l'incarner, elle dans le monde. Ainsi, bien que le projet d'élever un fils soit chargé d'ambivalence et mène à une inévitable amertume, il s'agit du seul projet qui permette à une femme d'être -d'être à travers son fils, de vivre à travers son fils.
Le projet d'élever une fille, d'autre part, est crucifiant. La mère doit réussir à apprendre à sa fille à ne pas être ; elle doit contraindre sa fille à développer le manque de qualités qui lui permettra de passer pour une femme. la mère est la principale missionnaire de la culture des hommes dans la famille, et elle doit contraindre sa fille à se plier aux exigences de cette culture. Elle doit faire à sa fille ce qu'on lui a fait à elle. Le fait que nous sommes toutes entraînées à être mères depuis la prime enfance signifie que nous sommes toutes entraînées à consacrer notre vie aux hommes, qu'ils soient nos fils ou non ; que nous sommes toutes entraînées à contraindre les autres femmes à illustrer le manque de qualités qui caractérise la construction culturelle de la féminité. "
LES FEMMES ET LA PEUR
" Qu'y a-t-il dans la crainte qui fait qu'elle oblige si efficacement les femmes à être de bonnes soldates dans le camp de l'ennemi ? "
" La crainte consolide ce système. La crainte est la glu qui fait tenir chaque élément à sa place. On apprend à avoir peur de la punition, inévitable lorsque l'on transgresse le code de la féminité imposée.
On apprend que certaines craintes sont en elles-mêmes féminines -par exemple, les filles sont censées avoir peur des insectes et des souris. En tant qu'enfants, on nous récompense pour avoir intégré ces craintes. On apprend aux filles à avoir peur de toutes les activités estampillées comme le territoire masculin -la course, l'escalade, les jeux de ballon ; les mathématiques et la science ; la composition musicale, gagner de l'argent, être chef. Quelle que soit la liste, elle pourrait ne jamais s'arrêter -parce que le fait est que l'on apprend aux filles à avoir peur de tout sauf du travail domestique et d'élever des enfants. Avant même que nous soyons femme, la crainte nous est aussi familière que l'air. C'est notre élément. On vit dedans, on l'inspire, on l'expire, et la plupart du temps on ne la remarque même pas. Au lieu de dire "J'ai peur", on dit "je ne veux pas", ou "Je ne sais pas comment", ou "Je ne peux pas". La crainte, donc, est une réaction acquise. Il ne s'agit pas d'un instinct humain qui se manifeste de façon différente chez les femmes et chez les hommes. Toute la question de l'instinct versus la réaction acquise chez les êtres humains est spécieuse. [il faut par exemple, selon Margaret Mead, apprendre aux enfants à redouter le feu que les animaux fuient instinctivement].
Nous sommes séparées de nos instincts, quels qu'ils fussent, par des milliers d'années de culture patriarcale. Ce que nous savons et la façon dont nous réagissons est ce que l'on nous a appris. On a appris aux femmes la crainte comme corollaire de la féminité, tout comme on a appris aux hommes le courage comme corollaire de la masculinité.
Qu'est-ce que la crainte, alors ? Quelles en sont les caractéristiques ? Qu'y a-t-il dans la crainte qui fait qu'elle oblige si efficacement les femmes à être de bonnes soldates dans le camp de l'ennemi ? La crainte, comme les femmes en font l'expérience, a trois effets principaux : elle isole, elle embrouille, elle affaiblit.
Lorsqu'une femme transgresse une règle qui énonce clairement quel comportement lui est approprié en tant que membre du sexe féminin, elle est repérée par les hommes, leurs missionnaires et leur culture comme une fauteuse de troubles. La mise à l'écart de la rebelle est réelle en ce qu'on l'évite, on l'ignore, on la punit, on la dénonce. Sa réacceptation dans la communauté des hommes, la seule communauté viable et approuvée, dépend de sa renonciation et de la répudiation de son comportement déviant.
Chaque fille fait l'expérience en grandissant de la forme et de la réalité de cette mise à l'écart. Elle apprend qu'elle est l'inévitable conséquence de toute rébellion, aussi infime soit-elle. Avant même qu'elle soit femme, la crainte et la mise à l'écart sont enchevêtrées en un solide nœud intérieur et elle ne peut pas faire l'expérience de l'une sans l'autre. La terreur qui assaille les femmes ne serait-ce qu'à la pensée de finir leur vie "toute seule" est la conséquence directe de ce conditionnement. S'il y a une "forme féminine de la perdition" sous le patriarcat, c'est sans nul doute cette peur de la mise à l'écart -une peur qui croît à partir de ces faits réels.
La confusion, aussi, fait partie intégrante de la crainte. Il est déroutant d'être punie parce que l'on réussit à grimper à un arbre, à exceller en mathématiques. Il est impossible de répondre à la question, "Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?". En raison de la punition qui est inévitable quand elle réussit, la fille apprend à associer la crainte à la confusion et la confusion à la crainte. Avant même qu'elle soit femme, la crainte et la confusion sont déclenchées simultanément par les mêmes stimuli et il est impossible de les distinguer l'une de l'autre.
La crainte, pour les femmes, les isole et les plonge dans la confusion. Elle les affaiblit sans relâche et petit à petit. Tout acte hors de la sphère autorisée d'une femme provoque une punition -cette punition tombe aussi inévitablement que la nuit. Chaque punition inculque la crainte. Comme un rat, une femme va toujours essayer d'éviter ces électrocutions à haute tension qui semblent miner le labyrinthe. Elle veut aussi trouver le Grand Fromage légendaire au bout.
Mais pour elle, le labyrinthe n'a jamais de fin. ".
Andrea Dworkin - Notre sang - Discours et prophéties sur la politique sexuelle. 1976
Je dédie ce billet et ce texte d'Andrea Dworkin à Chahinez Daoud, femme blessée aux jambes par balles puis immolée, anéantie par le feu pour avoir voulu reprendre de façon intrépide sa liberté d'être humain, en quittant un conjoint maltraitant. Elle a eu le tort de croire que la police et la justice l'aideraient dans cette entreprise : c'est aussi l'indifférence à son courage et la solidarité objective de la police et de la justice avec un milicien du patriarcat qui ont permis qu'elle perde la vie. Nous retiendrons qu'elle a préféré les affronter plutôt que de subir une vie de non-être femme. Et nous célébrerons son courage.
RIP Chahinez.
Les caractères en gras sont de mon fait.














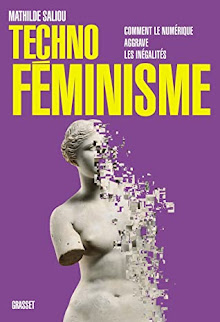








Une expérience mille fois renouvelée, l'exclusion ou la dérision pour prise de parole dans un cercle d'hommes.
RépondreSupprimer